Face à un monde complexe, une école du discernement
Alain BENTOLILA – 26/03/2025
Toutes les langues du monde –je dis bien toutes- possèdent cette capacité d’aller « plus loin que l’œil » ; toutes ont pour ambition de porter en effet la pensée de celui qui parle ou écrit bien au-delà du spectacle banal que le monde impose à ses yeux. Le pouvoir du Verbe libère ainsi l’Homme de la tutelle de l’évidence : il lui permet d’imposer son intelligence au monde et de combattre ainsi la dictature des apparences. A tous les élèves, y compris aux plus fragiles -j’oserais dire surtout les plus fragiles- l’Ecole apprendra que le « pensé » doit l’emporter sur le « perçu ».
Un exemple : « je crois que ça a tourné » (note : l’expérience me fut rapportée par mon ami, Yves QUERE, cofondateur de « La main à la pâte »)
Juin 2015, neuf heures du matin. La scène se passe dans la cour d’une école maternelle par une journée ensoleillée. La maîtresse place la petite Vanessa en un point précis de la cour et demande à Tiphaine de le marquer d’une croix. Puis Bilal est chargé de dessiner sur le sol le contour de l’ombre de Vanessa. Tous les enfants reviennent à 10 heures, Vanessa reprend sa place, un autre enfant dessine l’ombre projetée au sol. On fait de même à 11 heures, à midi et ainsi de suite jusqu’à 16 heures. Ainsi, à mesure que se sont égrenées les heures, se sont succédé les traces qui rappellent les différentes positions de l’ombre de Vanessa.
La maîtresse s’adresse alors à ses élèves et leur demande : « Que pensez-vous de ce que vous voyez par terre ? ».
Presque tous les élèves répondent en chœur : « Maîtresse, c’est une fleur ! ». Ils montrent du doigt les pétales et discutent pour savoir de quelle fleur il s’agit : rose pour les uns, marguerite pour les autres…
Mais cette maîtresse résiste fermement au « principe d’évidence », (comme toutes devraient le faire). Elle ne s’en laisse pas conter. Elle ne se contente pas d’un simple constat ; la seule nomination des choses ne la satisfait pas.
– Vous ai-je demandé de dessiner une fleur ? demande-t-elle.
– Non ! répondent les élèves, mais tu vois bien que c’est une fleur.
– Mais enfin, rappelez-vous ! Nous sommes venus ce matin à 8 heure et Vanessa s’est plantée là où il y a une croix. Et à neuf heure, nous sommes revenus et on a fait pareil, et après… et encore après…
Et elle insiste, et elle attend avec patience. Elle attend que jaillisse l’étincelle ; car cette maîtresse qui a de l’ambition pour ses élèves a fait le » pari de l’intelligence ». Au bout de longues minutes courageusement affrontées, son obstination est enfin récompensée : le petit Bilal, d’une voix timide, ose lui dire :
« Maîtresse, je crois que ça a tourné ».
Ah ! Comme cela valait la peine d’attendre ! « Je crois », a dit Bilal, montrant que c’est bien son intelligence qui était en marche et non pas seulement ses yeux qui constataient et identifiaient. Elle a dit ce qu’elle pensait et pas seulement ce qu’elle voyait. « Ça a tourné » l’a emporté sur « c’est une fleur ». Le verbe « tourner » l’a emporté sur le substantif « fleur ». Ce verbe, catégorie reine de la grammaire, qui donne à la langue son pouvoir de prévoir le futur et de faire resurgir le passé. Voyez donc comme la langue française fait bien les choses en nommant de la même façon ce verbe qui se conjugue et le logosqui impose au monde l’intelligence de l’homme. C’est bien cette singulière catégorie grammaticale des verbes qui hisse le langage humain au plus haut de ses ambitions : dépasser la question : « Qu’est-ce que c’est ? », pour tenter d’en affronter une autre d’un tout autre niveau : « Pourquoi les choses sont ce qu’elles sont ? ». Telle est l’ambition que l’Ecole doit avoir pour tous ses élèves.
Chaque étape de la construction d’une intelligence collective est le fruit du combat mené par chaque intelligence singulière pour dépasser le prévisible et l’évident et décider de les questionner. Cette intelligence collective se nourrit ainsi de la réflexion exigeante et des échanges fermes des hommes décidés à dépasser les apparences. Inhiber sa première impulsion, sa première intuition, ne pas se fier uniquement à ce qui « nous saute aux yeux » est donc un comportement intellectuel que l’on doit transmettre à tous les élèves -et notamment à ceux les plus en difficulté- sauf à accepter qu’ils deviennent des citoyens de deuxième zone, condamnés à la soumission et à la crédulité. L’inhibition est un processus remarquable d’adaptation, une prise de recul qui permet de résister à ses propres réponses impulsives. Le cerveau résiste à lui-même (Olivier HOUDE, apprendre à résister, Le Pommier, 2014). Mais la maturation de ce processus est lente au cours du développement de l’enfant et de l’adolescent. C’est pourquoi il faut éduquer les enfants à la maison et les entraîner intensivement à l’école ! C’est ce qu’on appelle « apprendre à résister ». Il est en effet urgent de concevoir et de mettre en œuvre dès l’école maternelle une pédagogie du contrôle cognitif, une pédagogie exigeante de la compréhension qui sera utile en lecture narrative mais aussi, transversalement, dans toutes les disciplines. La résistance cognitive a une vertu libératrice autant au niveau social qu’individuel. Elle donne aux citoyens la force intellectuelle de refuser la manipulation et la propagande ; elle permet à chaque individu de s’ouvrir lucidement au discours et à la pensée d’un autre.
L’école de la République ne peut se résoudre à ce que certains de ses élèves se bornent à contempler les apparences du monde. Elle doit les convaincre de tenter, dès l’école maternelle, de donner au monde forme et sens par l’exercice libre de leur intelligence. Désir d’apprendre (et non pas seulement « envie de savoir »), refus des faux semblants et rejet des compagnons douteux, telles sont les règles pour emprunter ce chemin d’espoir qui peut les conduire vers un monde de liberté individuelle et d’autonomie. Au cours de cette quête qui commencera dans chaque classe, dans chaque foyer au coin de chaque rue, ils rencontreront, je l’espère, des compagnons habités des mêmes exigences et des mêmes ambitions qu’eux ; mais il appartiendra à chacun de tracer sa propre route sans attendre qu’un quelconque prophète lui ouvre la voie. Cette quête est spirituelle parce qu’elle manifestera leur refus –qu’ils soient ou non croyants– de disparaître de ce monde sans y laisser la moindre trace de leur esprit singulier. Cette quête est intellectuelle parce qu’elle dira leur volonté de ne pas se laisser dicter leurs pensées et leurs actes. Cette quête enfin est politique parce qu’elle leur permettra de questionner avec la dernière exigence chacun de ceux qui prétendront leur dire dans quel monde ils doivent vivre.
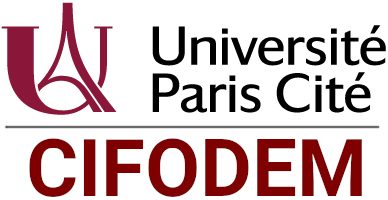
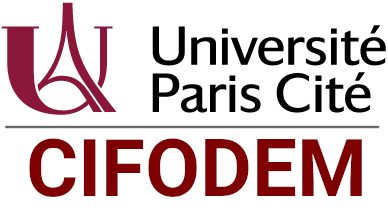
Comments are closed